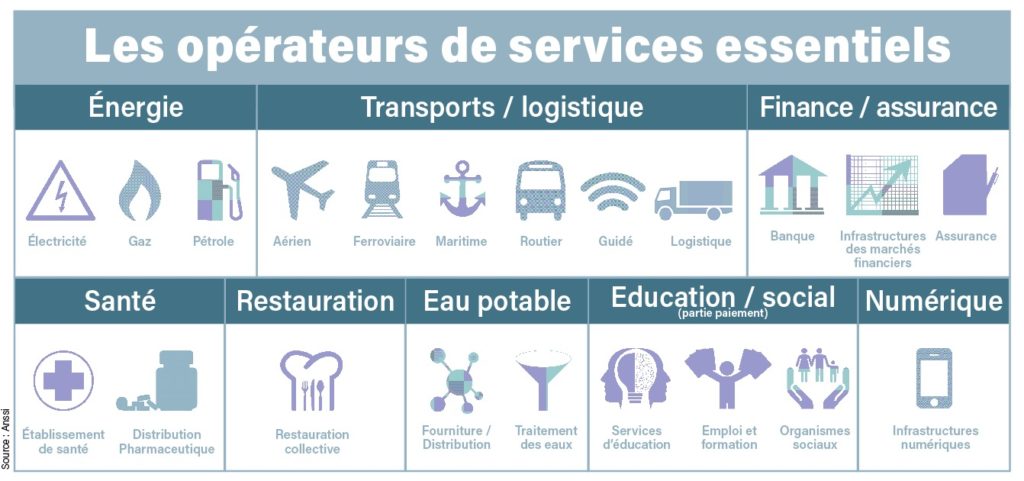Depuis l’été dernier, cent autobus électriques articulés du constructeur néerlandais VDL sont en service autour de l’aéroport international d’Amsterdam-Schiphol, sur le territoire de l’autorité organisatrice Amstelland-Meerlanden. Chaque jour, ils parcourent globalement plus de 30 000 km. C’est pour le moment la plus grosse exploitation d’autobus 100 % électriques de toute l’Europe.
Aux Pays-Bas, le « zéro émission » est aussi, ces temps-ci, la grande préoccupation. Et la capitale, Amsterdam, entend bien donner le ton. Le 15 avril 2016, un « agrément administratif » a été signé entre toutes les parties prenantes aux transports publics régionaux de voyageurs par autobus. Cet agrément ne manque pas d’ambitions. De fait, il stipule que, dès 2025, toutes les nouvelles acquisitions de véhicules neufs devront répondre au critère « zéro émission ». Il indique aussi que toute l’électricité alors utilisée devra intégralement provenir de sources renouvelables. Enfin, il décrète qu’à l’horizon 2030 seuls les autobus « zéro émission » pourront demeurer en circulation.
Pour l’organisation de ses transports de voyageurs, la région d’Amsterdam est divisée en quatre concessions. Une seule d’entre elles se trouve directement confiée à l’opérateur public GVB (Gemeentelijk Vervoerbedrijf, compagnie de transport municipale). Il s’agit, bien sûr, de celle qui régit les transports urbains (métro, tramway et autobus) dans la partie la plus centrale de l’agglomération. Les trois autres (qui ne concernent, au demeurant, que des lignes d’autobus) sont attribuées à la faveur d’appels d’offres périodiquement lancés au niveau européen. L’une de ces trois concessions est l’Amstelland-Meerlanden, dont le territoire présente la particularité d’inclure l’aéroport de Schiphol, avec un grand nombre de dessertes 24/7 (de zéro heure à minuit et du lundi au dimanche). Cette dernière concession a été remportée, en décembre 2017 et pour une durée de dix ans, par l’opérateur néerlandais Connexxion, qui compte aujourd’hui 5 800 collaborateurs et exploite près de 2 000 autobus. Le groupe Transdev possède 83 % des actions de cet opérateur, une banque néerlandaise détenant le reste.
Le rouge pour la région, le blanc pour l’aéroport
Les cent nouveaux autobus articulés 100 % électriques, tout récemment livrés par le constructeur néerlandais VDL pour l’Amstelland-Meerlanden, parcourent déjà, au total, plus de 30 000 km par jour. Ils se répartissent en deux sous-parcs aux spécifications légèrement différentes, utilisés sur deux réseaux étroitement interconnectés mais qui restent distincts dans leur concept opérationnel. Ces réseaux ont pour nom : « R-net » et « Schipholnet ». Le premier se caractérise par une vocation régionale et urbaine, et il s’étend de la zone aéroportuaire vers toute une partie de la conurbation. Son rôle essentiel consiste à relier les terminaux aux localités voisines, en s’immisçant toutefois jusqu’à la gare centrale d’Amsterdam. Ce réseau se dégroupe en quatre lignes dont la plus longue dépasse les 24 km, distance parcourue dans le temps d’une heure et une minute avec 34 arrêts. Il lui fallait donc des véhicules d’un niveau de confort supérieur, et aménagés intérieurement selon un diagramme privilégiant la capacité en places assises. Trois des quatre lignes de R-net circulent 24 heures sur 24. La fréquence peut atteindre huit passages par heure. Les autobus attachés à ce premier réseau se reconnaissent à leur livrée rouge orangé, qui les distingue de ceux de Schipholnet, uniformément peints en blanc. Plus dense, ce second réseau, lui, a pour mission essentielle de mettre en relation les différentes installations aéroportuaires entre elles, ainsi qu’avec les zones résidentielles du bassin d’emploi de Schiphol. En priorité, il cible les employés qui travaillent quotidiennement auprès de ces installations, mais aussi l’ensemble des passagers aériens en transit, au départ ou à l’arrivée. Surtout, il doit pouvoir faire face, chaque jour, à des flux importants de voyageurs se déplaçant entre les terminaux, les parkings, les bureaux et autres zones d’activité de l’aéroport dont il assure une desserte fine. L’accent a donc été mis sur la brièveté et la rapidité des trajets, ainsi que sur la capacité totale d’emport par véhicule. Le réseau Schipholnet, tel qu’il a été dessiné, ne compte pas moins de douze lignes, dont la plus courte mesure 4 km, et la plus longue ne dépasse guère les 17 km. En revanche, la fréquence peut y grimper jusqu’à 15 passages par heure ! Les parcours journaliers, par véhicule, varient entre 120 et 400 km sur R-net, et entre 150 et 500 km sur Schipholnet.
Seulement 20 minutes pour faire le plein d’électricité
Le dimensionnement préalable des sous-parcs nécessaires à l’exploitation de ces deux réseaux a conduit à prévoir, dès le départ, 49 véhicules pour le premier et 51 pour le second. Compte tenu de l’amplitude et de la densité assez remarquables (tout au moins aux yeux d’usagers français) des services sur ces lignes qui sont souvent exploitées 24 heures sur 24 sans interruption aux heures les plus creuses de la nuit, le choix s’est d’emblée porté sur le concept de charge rapide qui, seul, pouvait garantir la disponibilité et l’autonomie indispensables. Les batteries finalement retenues affichent une capacité de 169 kWh, et ont été conçues pour pouvoir être rechargées sous une puissance maximale de 420 kW. Cela signifie qu’une batterie vide redevient totalement opérationnelle en vue de la poursuite du même service après un stationnement pour charge rapide de seulement 20 minutes. Le dimensionnement des infrastructures nécessaires, compte tenu de la trame des services à assurer, s’est soldé par un choix de quatre lieux stratégiques où implanter les installations de recharge des batteries. A côté des 23 chargeurs « rapides » de marque Heliox, d’une puissance de 450 kW et répartis sur ces quatre lieux, on trouvera aussi 84 chargeurs « lents » de 30 kW, fournis par la même entreprise néerlandaise, et qui se situent tous en dépôt. Actuellement, la répartition géographique des installations selon ces quatre lieux d’implantation est la suivante : Schiphol Parking P30 (quatre chargeurs rapides), Schiphol Knooppunt Noord (quatre chargeurs rapides), Amstelveen Meerlandenweg (huit chargeurs rapides implantés sur des emprises provisoires), auquel s’ajoute l’ancien dépôt diesel reconverti de Schiphol Cateringweg (sept chargeurs rapides et 21 chargeurs lents de 60 kW à deux points de charge de 30 kW chacun). A terme, ce dépôt gérera 51 véhicules, tandis que les 49 autres seront rattachés au futur dépôt d’Amstelveen, qui est en construction sur un terrain contigu aux emprises de Meerlandenweg, et qui regroupera alors huit chargeurs rapides ainsi que vingt chargeurs lents, également de 60 kW et à deux points de charge. L’ensemble des infrastructures de recharge pour les cent véhicules représente une puissance totale de 13 MW. Sur une année, on devrait comptabiliser pas moins de 160 000 cycles de charge rapide ! La consommation d’électricité annuelle résultant de l’exploitation des deux réseaux R-net et Schipholnet serait équivalente à celle de 3 400 ménages. Et la réduction concomitante de dioxyde de carbone, dans le même laps de temps, atteindra les 15 000 t.
Un pantographe qui sert indifféremment aux charges rapide ou lente
Comme il est souvent d’usage dans les pays nordiques, Connexxion pratique le remisage à l’air libre, d’autant que les amplitudes journalières d’utilisation des véhicules sont déjà très élevées. Pour la charge rapide comme pour la charge lente, en ligne comme au dépôt, l’interface entre chargeur et véhicule se trouve réalisée par un pantographe ascendant de marque Schunk, qui est monté sur toiture, au-dessus de l’essieu avant. En se déployant, ce pantographe vient au contact de l’entonnoir solidaire de l’infrastructure, et dont les quatre barres conductrices peuvent, si nécessaire, être chauffées. Ainsi VDL a repris pour Amsterdam les dispositions constructives déjà mises en œuvre, avec succès, à Eindhoven. L’utilisation d’un seul pantographe conçu pour les deux modes de charge, sous la puissance de 450 kW comme sous celle de 30 kW, présente l’avantage, en dépôt, de permettre un remisage des véhicules aussi dense qu’avec un parc diesel conventionnel. Aux dires des techniciens de l’opérateur, le recours au seul système avec prise standard Combo 2 aurait nécessité, en revanche, d’intercaler des postes de rechargement entre les véhicules, à l’intérieur de la zone de remisage, sans parler des sujétions liées à la manutention manuelle des câbles de raccordement ou encore du risque d’arrachage accidentel de l’un d’eux en cas de remise en marche intempestive d’un véhicule. Compte tenu de l’importance inusitée du parc de matériel roulant à Amsterdam, on trouve pour la première fois, sur la zone de remisage à l’air libre du dépôt de Caterinweg, de longs portiques parallèles, qui enjambent toute la largeur d’emprise et portent, chacun, une série d’entonnoirs. C’est un mode d’organisation (et un « paysage ») de dépôt d’autobus que nous ne connaissions pas encore, mais qui pourrait devenir très courant dans les années à venir…
Un nez d’avion pour le bus de l’aéroport
Reflets de leurs conditions d’utilisation respectives, les deux sous-parcs d’Amstelland-Meerlanden ne diffèrent pas seulement par leur livrée, même si, techniquement, ils demeurent extrêmement proches. Ces deux véhicules articulés partagent, en effet, le même gabarit de 2,55 m, la même hauteur de 3,51 m et le même poids total en charge de 28,745 t. Leur chaîne cinématique est identique, avec un unique moteur central Siemens triphasé 1DB2022 d’une puissance de 210 kW sous 700 V, qui est apte à développer un couple de 3 800 Nm. Il en va de même, pour les deux véhicules, de leur alimentation électrique, qui fait appel à un pack de batteries d’une capacité de 169 kWh, organisé en quatre modules fixés sur le pavillon. Ces batteries sont refroidies à l’aide d’un circuit parcouru par un fluide caloporteur neutre pour l’environnement, en l’occurrence le R100.2. Après un parcours de 80 km, ce pack peut être rechargé en vingt minutes. Si, dans le modèle d’exploitation adopté pour l’Amstelland-Meerlanden, le pantographe Schunk de 450 kW reste privilégié pour les deux modes de charge, les véhicules sont néanmoins munis, à mi-longueur de leur face latérale droite, d’une prise de 60 kW au standard Combo 2, qui permettrait également un rechargement lent, au dépôt, le cas échéant.
Si le véhicule articulé rouge conçu pour le réseau R-net, de type SLFA-180, se caractérise par une longueur totale hors tout très exactement égale à 18 m, le véhicule articulé blanc SLFA-181 de Schipholnet, comme sa désignation peut le laisse deviner, mesure en réalité 18,15 m. Cette différence résulte du choix, pour le véhicule Schipholnet, de la face avant version BRT (Bus Rapid Transit), équivalent de notre concept BHNS (Bus à Haut Niveau de Service), et qui se traduit, pour ce véhicule, par un nez davantage profilé, dont la forme et la couleur blanche suggèrent quelque peu le cockpit d’un avion. Pour parfaire une certaine impression de fluidité, les roues des deuxième et troisième essieux ont été carénées. En revanche, le véhicule pour R-net reprend la face avant standard de la famille Citea, et il est naturellement dépourvu de tout carénage de roue.
Hormis l’aspect extérieur, les deux véhicules diffèrent aussi sensiblement sur les configurations d’accès et l’implantation des sièges. Le SLFA-180 possède, sur sa face latérale droite, trois portes Ventura à deux vantaux avec commande électrique, libèrant chacune un passage de 1 200 mm. La porte avant, correspondant à l’entrée, s’ouvre vers l’intérieur, tandis que les deux autres portes, réservées à la sortie, sont de type louvoyant-coulissant, avec vantaux se dégageant vers l’extérieur, afin de faciliter et d’accélérer la descente des voyageurs. Les aménagements intérieurs font appel à des sièges Kiel Lexxo CT avec appuie-tête. Une rampe UFR (Usagers en Fauteuil Roulant), à déploiement manuel, est montée au droit de la deuxième porte. Dans son implantation de sièges pour le R-net, le SLFA-180 offre 49 places assises et 78 debout, soit une capacité totale de 127 voyageurs. Deux équipements Thermoking 700H, du type « pompe à chaleur », assurent la climatisation intérieure, hiver comme été. Pour le chauffage, il peut être aussi fait appel, en cas de besoin, à l’énergie calorifique dégagée par les résistances de freinage rhéostatique, voire, en période de très grand froid, à un brûleur auxiliaire Webasto qui utilise un carburant bio-diesel. L’éclairage intérieur à LED et des prises USB complètent ces aménagements.
Le SLFA-181 de Schipholnet partage les mêmes éléments de confort que le SLFA-180 de R-net. Toutefois, il s’en distingue par la configuration des portes, au nombre de quatre, dont celle pour l’entrée des voyageurs, à l’avant, ne dispose que d’un seul vantail de 600 mm à ouverture rapide par coulissement vers l’extérieur. Les trois autres portes demeurent identiques à celles du SLF-180. Le véhicule de Schipholnet offre 45 places assises et 79 debout.
Pas question de livrer simplement les véhicules dans la cour de l’opérateur !
Qu’il s’agisse du dimensionnement des parcs de véhicules, ou de celui du nombre et de la puissance des stations de charges, rien ne s’est fait ici sans une collaboration extrêmement étroite entre l’opérateur et le constructeur. Au plan général, on a déjà bien compris que ce serait là un nouvel invariant de l’électromobilité, sauf que, pour le néerlandais VDL, l’importance de cette démarche apparaît absolument capitale. Pas question pour lui de venir simplement livrer chez son client les autobus commandés ! Tout au contraire, le constructeur a monté ex nihilo une structure dédiée, dénommée « Enabling transport solutions » (structure facilitant l’élaboration de solutions pour le transport), qui a pour mission de procéder, avec l’opérateur, à toute l’étude technique préalable, en prenant en compte l’ensemble des contraintes d’exploitation de ce dernier. Un travail itératif très important s’instaure ainsi, dès le début, entre les deux parties. En quelque sorte, VDL joue le rôle d’entreprise pilote, en planifiant avec l’opérateur l’ensemble des travaux, puis en assumant la responsabilité des différentes phases de livraison de l’ensemble du projet d’électromobilité, y compris pour la totalité des infrastructures nécessaires. Il est vrai que VDL n’en est plus à son coup d’essai ! Pour lui, l’aventure de l’électromobilité avait commencé dès 2013, lorsqu’il présenta, à Genève, le premier autobus Citea SLF-120 Electric, à la faveur du salon UITP (Union internationale des transports publics). A l’époque, le constructeur avait aussitôt saisi l’intérêt de se concentrer très fortement sur la mobilité 100 % électrique. Sa première réalisation, en avril 2015, concerna la ville de Münster (Allemagne), avec cinq Citea SLF-120 Electric, dont quatre fournis dans le cadre du projet ZeEUS (Zero emission bus system). A peine quatre mois plus tard, en octobre 2015, VDL livrait le premier de huit Citea SLFA Electric aux KVB (Kölner Verkehrs-Betriebe, entreprises de transport de Cologne), permettant à l’opérateur rhénan d’exploiter entièrement, dès 2016, sa ligne 133 en mode 100 % électrique. Avec les KVB, VDL a pu se forger une première expérience significative dans le domaine du partenariat constructeur-opérateur qu’il lui semblait si important d’instaurer sur tout projet d’électromobilité, aux seules fins d’optimiser les futurs résultats en exploitation commerciale. Sur le marché néerlandais des transports en commun 100 % électriques, le constructeur joue, bien entendu, un rôle de pionnier. On pense, tout naturellement, à la concession de l’autorité organisatrice du Brabant Sud-Est (groupe Transdev), centrée sur la ville d’Eindhoven, avec son parc de 43 Citea articulés SLFA Electric déjà présenté dans nos colonnes. Le 18 avril 2017, tout juste quatre mois après la mise en service du réseau, le cap du million de kilomètres parcourus était franchi ! La même année, VDL a livré 14 Citea SLF-120 Electric, quatre Citea SLFA-180 Electric et 12 Citea LLE-99 Electric au groupe Arriva pour les concessions de la Frise et du Limbourg.
Le constructeur travaille avec une dizaine d’opérateurs et d’AO
Chemin faisant, le constructeur néerlandais est ainsi devenu, apparemment sans difficulté, le leader incontesté du marché européen en matière d’électromobilité. Outre aux Pays-Bas et en Allemagne, des Citea 100 % électriques circulent au Luxembourg. Jusqu’à présent, VDL a réalisé, au total, 14 projets de ce type, mettant en œuvre 220 véhicules qui ont déjà parcouru plus de dix millions de kilomètres. Actuellement, le constructeur néerlandais travaille aussi avec une bonne dizaine d’autres opérateurs et autorités organisatrices en Belgique, Suisse, Suède, Norvège, et également en France. Il entend bien conforter sa position de leader européen dans les prochaines années. Sa raison sociale complète, VDL Bus & Coach, rappelle qu’il fait partie de VDL Groep (groupe VDL). Ce groupe international, dont le siège est situé à Eindhoven, a pour vocation première le développement, la production et la vente de produits industriels, semi-finis ou déjà prêts à l’emploi, dans les secteurs de l’automobile, des autobus et des autocars. Chaque année, 1 500 bus et cars quittent ainsi les chaînes de fabrication aux Pays-Bas ou en Belgique. Toutefois, le groupe œuvre aussi dans des domaines hautement scientifiques comme les télescopes géants, les accélérateurs de particules, ou encore la conquête spatiale. L’entreprise familiale, créée en 1953, est devenue, au fil du temps, une société tentaculaire qui compte aujourd’hui 97 filiales réparties dans une vingtaine de pays, avec plus de 17 000 collaborateurs et un chiffre d’affaires annuel supérieur à cinq milliards d’euros. Au-delà des chiffres, la force du groupe réside indubitablement dans les synergies de collaboration qu’avec constance et méthode celui-ci a réussi à mettre en œuvre entre les différentes entreprises qui le composent. C’est tout simplement impressionnant, et augure bien de nouveaux succès pour le constructeur néerlandais.
Philippe Hérissé