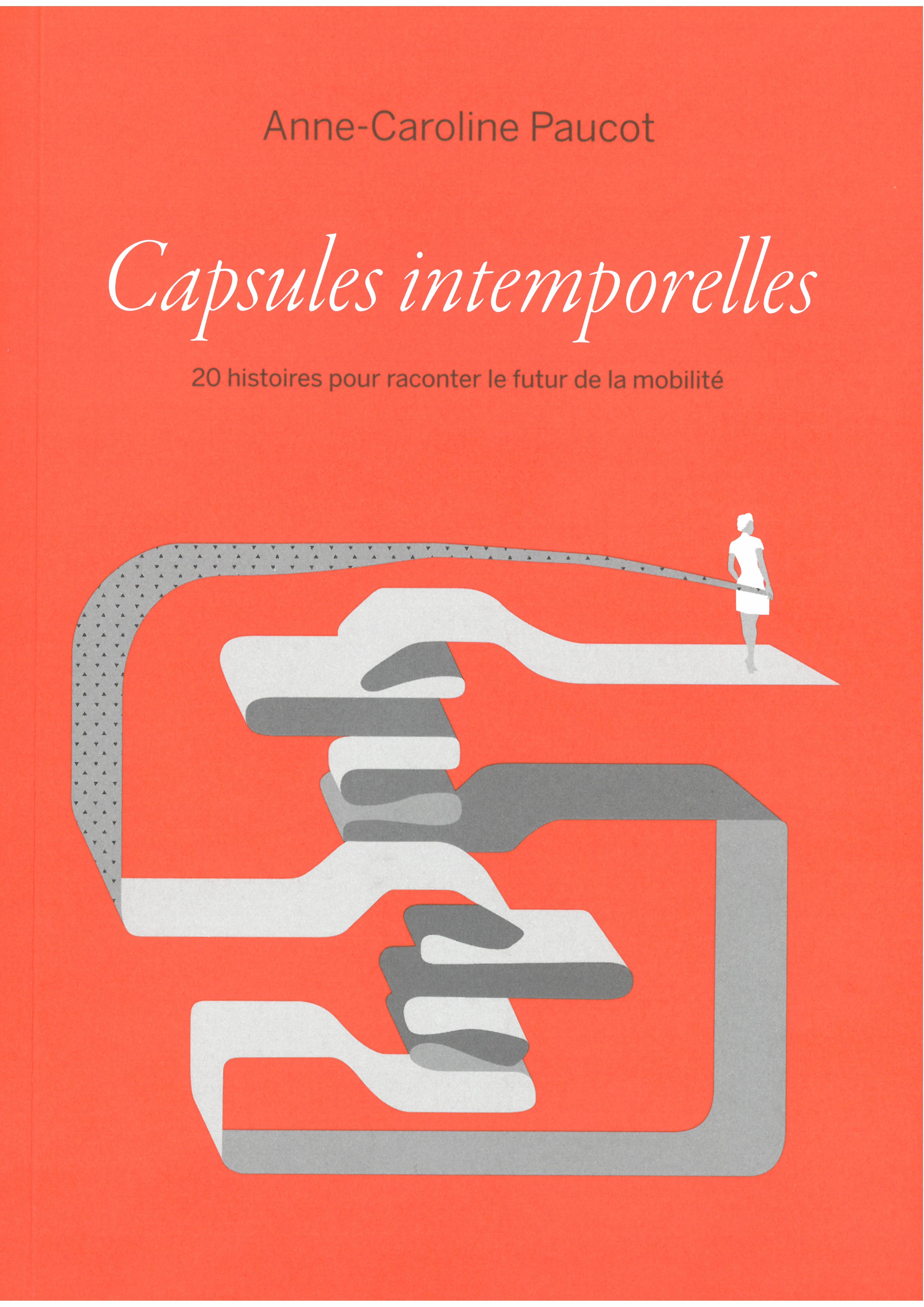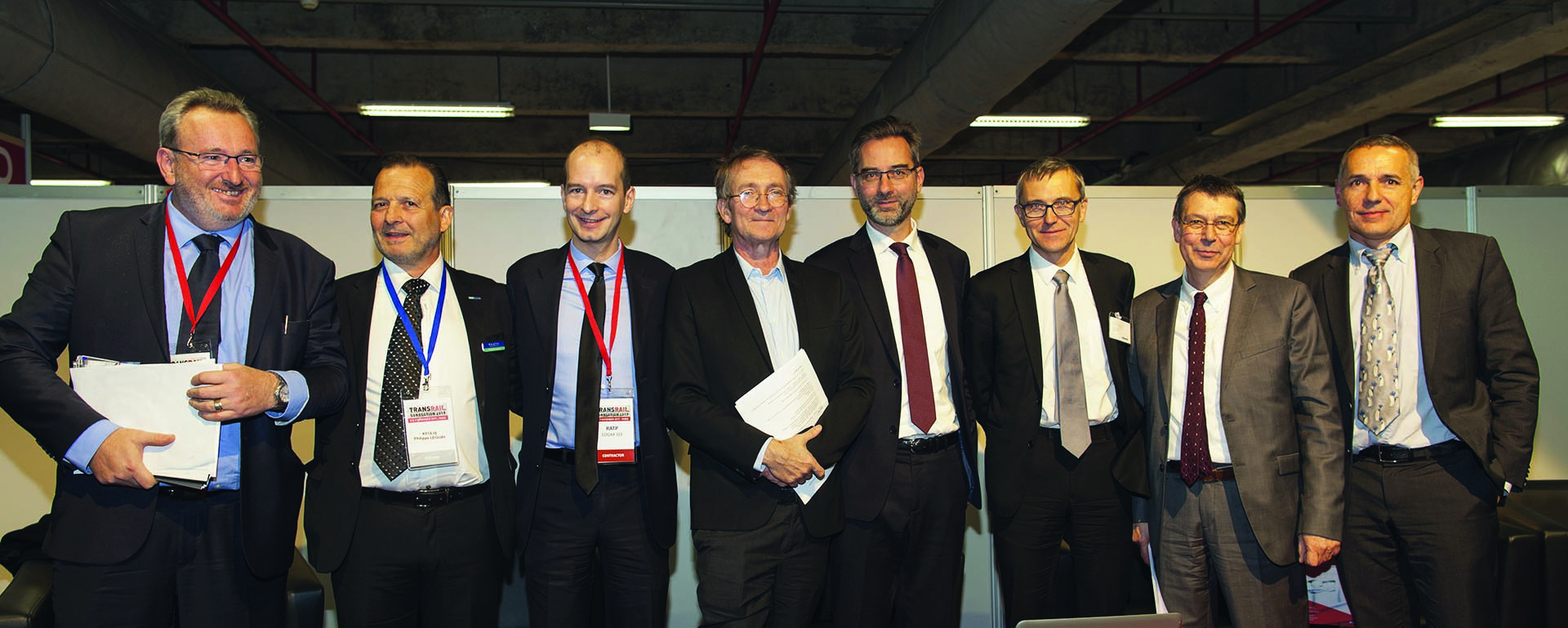L’électricité semble être l’avenir des autobus, mais difficile pour les opérateurs de choisir entre les différentes options technologiques proposées. Pour faire le point, le Club VR&T avait invité des constructeurs. Alexandre Desneux, a présenté les Bluebus de Bolloré. Des véhicules électriques proposés en 6 et 12 mètres, made in Bretagne. Le groupe Bolloré, qui débute pour les bus, met en avant son expérience des batteries lithium métal polymère qui, dans ses voitures, ont déjà parcouru 160 millions de km, avec une autonomie de 180 à 250 km. « Notre bus a été construit comme un véhicule au gaz, avec 2×4 packs de batteries, sans chauffage, la partie refroidissement étant compactée à l’arrière. L’intérieur du véhicule a été conçu autour de la batterie, avec un habitacle bénéficiant de beaucoup de lumière », décrit M. Desneux qui préconise « une charge nocturne lente, en 3 heures, via une prise combo, pour préserver la batterie ». Mais le constructeur peut aussi installer un pantographe en option. Bolloré a un partenariat d’innovation avec la ville de Rennes, et à Paris, son Bluebus 12 mètres équipe la ligne 341 de la RATP depuis fin 2016. Ce qui lui permet d’avoir un retour d’expérience. Bluebus a également fait l’objet de démonstrations à Amiens, Lorient, Agen, Chamonix, Strasbourg, Montpellier, Nice et Grenoble… « On a fait la preuve de l’autonomie et de la fiabilité. » Si le prix du véhicule reste élevé, Bolloré travaille à le réduire. « On estime que le bus électrique pourra être l’an prochain au niveau de l’hybride, et on pense pouvoir être entre le prix du diesel et du GNV en 2020. » L’usine Bolloré de Quimper produit des batteries, et dispose de deux lignes d’assemblage de bus, avec une capacité de 200 véhicules par an, mais tablant sur une forte demande, le groupe réfléchit à la construction d’un nouveau site de production.
« Volvo croit tellement à l’électromobilité que son président a décidé d’arrêter les bus diesel il y a 12 ans et de lui consacrer sa recherche et développement », rappelle en préambule Patrick Damian, directeur général de Volvo bus France. « L’électromobilité est une rupture technologique. Ce qui dit veut dire différents standards et différentes solutions. » Volvo a fait le choix de se passer des batteries. « On pense que moins il y en a, plus on est efficace, car c’est moins de poids et plus de passagers. » Les bus Volvo se rechargent rapidement, par pantographe inversé avec le concept OppCharge, « une solution de rechargement standardisée déjà retenue par plusieurs constructeurs, compatible bus, voitures et poids lourds, précise M. Damian. S’équiper de ces chargeurs permet d’offrir un système ouvert à tous. Une municipalité ou un opérateur peut être propriétaire des stations de recharge et faire un appel d’offres auquel des constructeurs concurrents pourront répondre pour proposer leurs véhicules. Notre projet de pantographe, c’est le projet d’une ville, car ces appareils peuvent être utilisés notamment pour les camions destinés aux traitements des déchets ménagers dans d’autres plages horaires. Si on électrifie la ville, on a la possibilité que tout le monde puisse les utiliser et d’arriver à l’électrification globale des transports », plaide M. Damian. Volvo Bus propose une offre complète de véhicules avec trois longueurs et trois technologies : hybride parallèle, électrique hybride et full électrique, avec pour chacun un coût au kilomètre, de la vente de véhicules, de la location de batterie, « et on assume les risques en garantissant le fonctionnement du véhicule », souligne M. Damian. « En périurbain, l’hybride parallèle permet d’économiser jusqu’à 39 % de consommation, l’hybride électrique, qui se met en pilotage pour choisir l’énergie en fonction des zones traversées, permet de réduire jusqu’à 75 % les émissions, et le full électrique est 100 % propre et permet une réduction de la consommation de 90 %. On n’a pas la prétention de dire que notre système de bus électrique peut fonctionner partout, mais le pantographe fixe coûte moins cher que d’en installer un par bus. »
Heuliez Bus France, se présente comme le premier constructeur national de véhicules hybrides et d’autobus en 2016, avec 500 salariés dans les Deux-Sèvres. « Nous avons acquis une base solide en électromobilité, grâce à 580 véhicules en exploitation qui ont parcouru 43 millions de kilomètres, et nous ont permis d’avoir un retour d’expérience », détaille Eric Baleviez, responsable des Ventes qui met en avant le PPP de Dijon et ses 102 véhicules dont Heuliez assure aussi la maintenance de la chaîne de traction, « ce qui nous a permis un enrichissement de problématiques ». Eric Baleviez poursuit : « L’hybridation nous a apporté une maîtrise des processus de récupération de l’énergie au freinage et la maîtrise du mode full électrique. On en a tiré une architecture GX électrique, qui nous permet de nous préparer aux différents marchés. On est capable d’analyser le profil d’une ligne et de modeler les données pour proposer une technologie aux clients selon la fréquence, le nombre de passagers, et s’engager sur des performances atteignables. » Les autobus Heuliez de 12 mètres sont proposés avec deux batteries : Energie et Puissance. Les batteries Puissance, qui se rechargent à 450 kW contre 70 pour les charges de nuit, permettent d’embarquer quatre fois moins d’énergie et ont une durée de vie de huit à dix ans, contre 15 à 17 ans pour les Energie, soit une longévité proche de celle des véhicules. Le bus articulé d’Heuliez ne sera disponible qu’en Oppcharge dans un premier temps, pour des problématiques de charge à l’essieu. « Parce qu’on préfère embarquer 150 à 160 passagers plutôt que des batteries. On va décliner notre offre en quatre familles de véhicules électriques et adjoindre l’énergie, l’interface de charge, le pantographe ou le chargeur et proposer des contrats de full maintenance sur la durée de vie », annonce Eric Baleviez. Les premières livraisons des 12 m à charge lente d’Heuliez sont prévues pour cette fin d’année et les 12 et 18 m à charge rapide fin 2018. Le représentant d’Heuliez insiste également sur la nécessité d’accompagner le changement en raisonnant en système de transport. « Il faut du pragmatique et s’engager sur les performances. Comme chaque contexte est différent, il faut une analyse précise des besoins, un engagement fiable sur le TCO [Total cost of ownership soit le coût total de possession, NDLR], garantir la sécurité, et ne surtout pas dégrader la qualité de service offert. Il faut intégrer l’impact du coût sociétal, le coût de la maintenance dans les TCO, et prévoir l’évolution des parcs. »
Dietrich Carebus, troisième acteur du marché français pour les autocars s’est allié au Chinois Yutong pour produire des bus électriques. Pierre Reinhart, président de DCG-Yutong justifie : « Avec Yuton, DCG s’est entouré d’un constructeur qui fait 15 % du marché mondial, avec 37 000 bus et cars électriques sur le marché. La Chine représente 97 % du marché des bus électriques en circulation. Et si en France on a toujours peur que les Asiatiques nous volent la technologie, là on fait l’inverse. On va assembler chez nous en profitant de leur expérience. » En 2016, DCG-Yuton a réalisé les premiers essais sur les réseaux, ses véhicules ont parcouru 50 000 km en exploitation, et le constructeur a livré son premier véhicule électrique à Keolis, en mai 2017, à Orléans. Pierre Reinhart précise que Yutong ne développe pas sa batterie mais les achète. « On fournit des véhicules avec chargeur de nuit. Quand les prises Combo2 seront capables d’absorber plus d’énergie, on pourra charger à 300 kW une fois par jour avec la même technologie. Notre cahier des charges prend en compte le fait que les véhicules coûtent plus cher, ils doivent donc durer plus longtemps pour pouvoir être amortis. Notre objectif est de réduire le poids de la batterie et d’augmenter sa capacité pour qu’on puisse utiliser les bus électriques comme le diesel. » Le constructeur précise qu’en Asie 80 % des véhicules en circulation rechargent de nuit. DCG-Yutong propose un véhicule électrique 12 m et travaille sur le 18 mètres à batterie LFP, avec une solution chauffage et clim 100 % électrique, pouvant transporter 92 passagers avec 200 à 250 km d’autonomie. Son autocar électrique d’une capacité de 55 à 59 passagers sera disponible mi-2017. « Nous proposons une offre complète : on amène le chargeur, le véhicule, une offre de location de batteries et un outil de suivi d’exploitation », précise M. Reinhart. DCG-Yuton a un projet de ligne assemblage en France pour 2018, avec une capacité de 300 véhicules par an.
Alstom est un acteur de l’électromobilité depuis 100 ans avec le tram et le métro, et le constructeur veut capitaliser sur cette expérience pour proposer un bus conçu à partir d’une feuille blanche. Bruno Marguet, vice-président Stratégie d’Alstom explique que « de cette page blanche est né un bus à accès plat baptisé Aptis, qui n’a que quatre roues, réparties aux deux extrémités, ce qui permet de donner de l’espace aux passagers, et pour être maniable, les deux essieux sont orientables. Ce bus offre une capacité de 100 personnes et a été conçu pour durer 20 ans. » Quant à l’aménagement intérieur, il est flexible, permet d’installer jusqu’à trois portes de tramways, plus larges, pour plus de confort des passagers et bénéficie d’une surface vitrée importante. Ce véhicule peut être chargé de manière lente, de jour, ou rapide, de nuit, par le sol ou avec un pantographe. « Nous voulons offrir une solution complète : véhicule, maintenance, infrastructure, énergie, avec une vision système ou véhicule, et comptons bien prendre des parts de marchés à nos concurrents », conclut M. Marguet.
Encore bien des questions
Après ce passage en revue de l’offre, les exploitants ont posé des questions, s’interrogeant notamment sur la durée de vie des véhicules électriques. Les constructeurs s’accordent à assurer des durées de vie plus longues pour les bus électriques que pour le thermique, de manière à compenser des coûts plus élevés. « Les moteurs et la chaîne de traction sont dimensionnés pour 40 ans et nos bus électriques ont une durée de vie assurée de 20 ans sans problème », assure Eric Baleviez pour Heuliez, qui précise qu’avec l’électrique, il y a un gain de maintenance. DCG-Yutong garantit ses chargeurs cinq ans, ses batteries huit ans, « au-delà on perd en autonomie mais cela peut suffire sur certaines lignes », précise M. Reinhart qui ajoute, « un moteur électrique s’use moins. Il peut faire 800 000 à un million de kilomètres, soit 20 ans à raison de 50 000 km par an ». Autre interrogation, quid des auxiliaires de confort ? Le chauffage et la climatisation sont gourmands en énergie et peuvent nuire à l’autonomie des véhicules. Heuliez reconnaît que le chauffage peut représenter 25 % de la consommation s’il est fait en électrique. « On recherche le chauffage de demain, qui pourra être du chauffage à pompe de chaleur ou radiant », détaille Eric Baleviez. Même piste pour Bolloré. « Nous utilisons un chauffage électrique radiant, innovant, plus intelligent, qui permet de l’optimisation. Et on étudie avec l’exploitant suivant le besoin, quitte à dégrader le service certaines journées, ou faire de la charge rapide, ce sont des contraintes d’exploitation supplémentaires avec des réponses différentes suivant les besoins », reconnaît le constructeur. Pour apporter une réponse sur ce point, Volvo a été en Chine tester les différentes solutions existantes et a fait le choix « d’utiliser l’énergie quand on en a besoin, plutôt que la transporter aux dépens des passagers », argumente Patrick Damian. Pour les éléments annexes de confort, Yutong utilise une pompe à chaleur sur le toit, mais M. Reinhart reconnaît qu’en cas de températures extrêmes cela ne suffit plus, et qu’il faut basculer vers l’électrique. Il plaide pour des réglages réalisés par les opérateurs afin d’éviter la surconsommation.
Alain Pittavino, directeur Métiers de Transdev constate que l’offre actuelle ne propose pas encore des véhicules de 18 mètres et s’en inquiète. Un peu de patience, lui répondent les constructeurs. Heuliez, reconnaît avoir fait le choix de lancer en priorité un 12 mètres pour 95 à 100 voyageurs correspondant bien au marché, mais assure que le 18 mètres arrive avec une autonomie de 50 km. Patrick Damian poursuit pour Volvo : « On avance par étapes. On en est à 12 mètres en série avec 105 passagers avec l’ambition d’avoir un coût inférieur ou égal au diesel, et on va lancer le 18 mètres. Il n’existe pas de choix technologique sur la batterie, mais on progresse pour le chargement lent, comme pour le rapide. On va essayer d’avoir une gestion d’énergie adaptée aux besoins. » Bolloré travaille au 18 mètres pour 150 passagers, avec comme objectif d’augmenter la capacité de la batterie. « C’est réalisable, car sa capacité a déjà gagné 50 % en quelques années », assure Alexandre Desneux. Quant à DCG-Yutong, il a également en projet un 18 mètres avec comme cahier des charges de transporter 140/150 passagers avec 300 km avant recharge, et un objectif de réduction des coûts.
Interrogés sur la conduite automatique, les constructeurs estiment que si la technologie est prête, beaucoup reste à faire pour que cela puisse être réalisable et accepté. Volvo propose déjà de la conduite autonome dans une mine du nord de la Suède, Heuliez fait circuler un véhicule agricole autonome roulant dans des champs, mais proposer des bus autonomes en ville, c’est une autre histoire. « On évolue dans un environnement urbain et complexe. C’est plus compliqué. Volvo propose un système de vigilance chauffeur assisté et nous avons développé un système de détection piétons et cyclistes qui informe le conducteur pour qu’il prenne la meilleure décision. On ne va pas au-delà pour des raisons éthiques et juridiques », explique Patrick Damian. Yutong teste depuis quatre ans un véhicule de 15 mètres autonome en full électrique que les passagers peuvent appeler via une application. « Ce véhicule arrive et s’arrête pour prendre les voyageurs. Mais en raison des contraintes éthiques et de législation, il faudra encore être patient pour voir arriver ces véhicules », admet M. Reinhart.
Des premiers pas prometteurs
Et les exploitants, où en sont-ils de leur démarche de transition énergétique ? « Nous avons réalisé des essais de véhicules électriques sur certaines de nos lignes régulières qui nous ont permis d’avoir un retour d’expérience », se félicite Patrice Lovisa, directeur du département Bus de la RATP. « Nous maintenons notre projet 2025 de 80 % de véhicules électrique et 20 % au gaz, et dès 2020 nous devrions être parvenu à 50 % de transition énergétique. La ligne Paris – banlieue 341 est déjà 100 % électrique avec des véhicules 12 m Bolloré. Sur d’autres lignes on teste régulièrement des bus électriques ou au gaz. Pour nous l’enjeu ce sont les coûts d’acquisition et le cycle de vie, et de veiller à ce que l’arrivée de ces nouvelles technologies ne pénalise pas l’offre voyageur. » Autre enjeu pour la RATP, la connexion électrique de ses dépôts où il y a faudra recharger jusqu’à 200 bus. La régie a choisi de charger les véhicules en dépôt, de nuit, plutôt que de déployer de la technologie dans Paris, en raison des investissements que cela aurait demandés. « On ne pourra pas les charger tous en même temps, il faudra faire un travail de lissage. » Et comme les dépôts ne sont pas prévus pour des bornes de recharge, la RATP doit revoir l’utilisation de l’espace et la sécurité incendie liée à l’arrivée d’installations électriques. Comme l’autonomie actuelle des véhicules, de 180/200 km ne permet pas de couvrir toutes les lignes, il faut trouver des solutions complémentaires, comme des charges en terminus, le temps que la technologie progresse. Voilà pour les contraintes techniques. Mais côté utilisateurs, « les retours sont très positifs. Les voyageurs ont conscience de ce que ces véhicules apportent en termes de pollution et de bruit. L’absence de bruit devient même un problème. Trop discrets, les véhicules ne sont plus entendus et peuvent être source d’accidents. On a également un retour positif des conducteurs sur le confort de conduite, plus souple, moins saccadé », précise M. Lovisa. La RATP n’a pas relevé de problème de confort climatique, mais reconnaît que l’hiver n’a pas été rude. Le directeur du département Bus ajoute que le changement de matériel devra se doubler d’un accompagnement des métiers de maintenance à cette transition.
Alain Pittavino voit dans l’électromobilité « une opportunité pour le transport public de rénover son image, d’attirer davantage de passagers et d’augmenter sa fréquentation ». L’exploitant qui veut être acteur du changement réalise actuellement un travail de tests, de confirmation des promesses constructeurs. Mais pour Transdev la transition énergétique doit aussi être l’occasion de faire preuve d’imagination sur la manière d’exploiter les véhicules, de ne pas faire comme avec le thermique, d’où la nécessité de penser système. C’est ce qui a été fait à Eindhoven, aux Pays-Bas où Transdev exploite 43 véhicules, alors qu’il n’en a besoin que de 36. « On charge de nuit les bus articulés en semi-rapide, qui lors de leur exploitation ressortent quatre fois par jour pour aller faire une charge complémentaire. D’où le nombre de véhicules. On a dû s’adapter aux contraintes. De cette expérience on a la certitude qu’il faut penser différemment l’électromobilité, c’est pourquoi on met en place une boîte à outils à disposition des collectivités locales pour leur proposer des solutions adaptées à chaque territoire », conclut le directeur Métiers de Transdev.
Youenn Dupuis, directeur adjoint de Keolis observe une effervescence autour du véhicule électrique. « Il y a à la fois une appétence et des développements tous azimuts. Les collectivités françaises ont joué un rôle en donnant le top départ. Il reste encore des options de principe, des présupposés, des paris technologiques, même si on constate une convergence des options, constate-t-il. Et chez Keolis on a choisi de travailler avec différents constructeurs : Volvo en Suède, Heuliez à Dijon, Bolloré à Rennes, Yutong pour le premier bus à Orléans et Alstom pour la ligne 23 à Versailles. » Mais pour l’exploitant, l’électromobilité c’est aussi les navettes autonomes, « comme Navya que nous avons testé à la Défense en septembre, et à Lorient nous exploitons un catamaran électrique de 22 mètres pour faire une traversée qui évite un long trajet en voiture. L’arrivée des bus électriques nécessite de raisonner par approche systémique. Il faut trouver le bon système au bon endroit, ville par ville, ligne par ligne, saison par saison. Le contexte local est important pour choisir la bonne technologie pour chaque cas. » Pour réussir le passage à l’électromobilité Youenn Dupuis insiste sur trois points : « La sécurité, car il y a un risque lié aux batteries et à leur recharge. L’autonomie. L’auxiliaire chauffage/clim peut être à l’origine de pics. Faut-il dimensionner le système à ces pics, ou mettre des appoints pour les gérer ou les lisser. Et enfin, la maintenabilité. Il faut garantir une solution qui tienne dans la durée. » Pour que les choses aillent dans le bon sens et pouvoir choisir en connaissance de cause, Keolis a proposé au Stif de construire une plateforme d’évaluation des performances en conditions réelles d’exploitation des différents véhicules en conditions d’exploitation identique.
Valérie Chrzavzez-Flunkert